Le canonnier Klaus Rohwedder relate le naufrage du Tirpitz le 12 novembre 1944:
 « Ce dernier bombardement, je l’ai vécu dès le commencement de l’attaque et je vais vous l’évoquer. Les avions anglais volaient en formation serrée côté tribord et provenaient de la direction du Balsfjord.
« Ce dernier bombardement, je l’ai vécu dès le commencement de l’attaque et je vais vous l’évoquer. Les avions anglais volaient en formation serrée côté tribord et provenaient de la direction du Balsfjord.
Comme nous étions déjà postés à nos emplacements de tir suite à l’alerte aux avions, nous pouvions clairement suivre les péripéties. Nous attendions la venue de nos chasseurs faisant partie de l’escadrille dite de la Mer de Glace stationnés à Bardufoss prévus pour attaquer les bombardiers Lancaster, mais aucune aide ailée n’arriva, bien que les haut-parleurs du bord avaient annoncé leur intervention. La peur se lisait dans les yeux, beaucoup de matelots supposaient que ce serait le dernier jour de leur existence. Après que l’artillerie lourde eut ouvert le feu et que les salves détonaient loin en-dessous des attaquants, ces derniers se disséminèrent, en maintenant cependant leur angle d’attaque. Quand nous reçûmes l’autorisation de leur tirer dessus alors qu’ils s’approchaient du navire, la tension terrible que je ressentais en moi jusqu’alors tomba.
Je vis encore comment une machine volante largua une bombe, comment celle-ci poursuivit un chemin parallèle avec le vol de l’avion avant que je ne la perde de vue. L’espace d’un instant, je devinai son ombre se profilant à l’arrière, loin du navire.
Elle provoqua une énorme cascade au contact de la surface de l’eau qui enfla démesurément et envoya une gigantesque cataracte dans le ciel. Abritée des tirs, notre Flak légère riposta à son tour contre la formation ennemie qui évoluait à quelque 4 500 mètres au-dessus de nous. Nos tirs provoquaient un bruit indescriptible et dans ce vacarme infernal l’on ne pouvait guère distinguer les détonations émises par les différentes munitions tirées.
Le fracas assourdissant s’amplifia encore lorsqu’un énorme choc, le premier encaissé à bâbord, fit trembler le bateau. Il tomba une grande quantité d’eau sur nous. Lors de la deuxième frappe, le bâtiment s’inclina aussitôt à bâbord. Les munitions ne parvenaient plus aux tourelles de tir. J’empoignai encore quelques obus dans le compartiment réservé à leur rangement car l’accès à l’ascenseur donnant sur la soute était bloqué par une chaloupe arrachée de ses bossoirs. De ce fait, les pourvoyeurs de munitions n’arrivaient plus aux canons.
Entretemps, la gîte s’était accentuée ce qui fit que je ne pus plus armer le tube. L’obus que j’essayais d’engager dans le fût glissa du bloc de la culasse mobile et tomba du pont cuirassé dans l’eau où d’autres débris le rejoignirent. Je me rendis alors compte que, de tout l’effectif de notre personnel de tir, il ne restait plus qu’un camarade qui servait avec moi la mise à feu. Les restants se trouvaient à l’intérieur du coffrage blindé du canon.
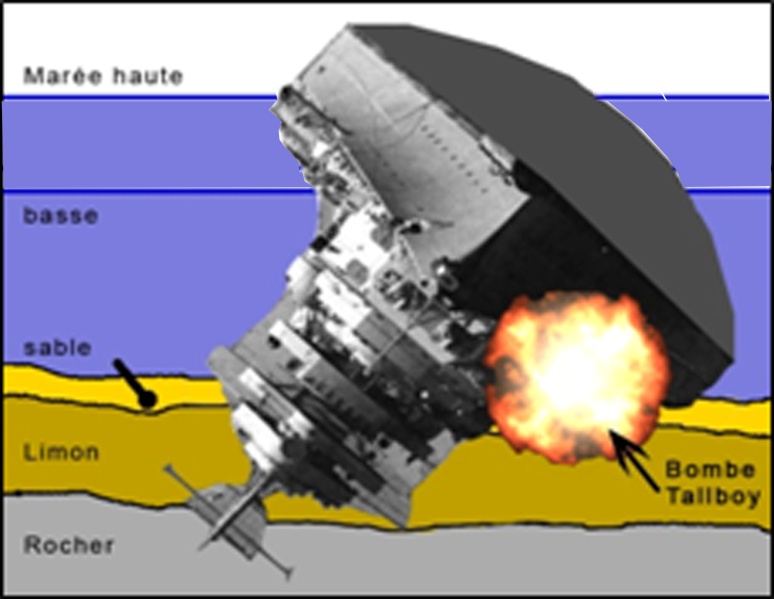 Bientôt, il nous devint impossible de nous tenir debout sur le pont et nous nous agrippâmes au bastingage. Nos tirs de réplique baissèrent d’intensité, seuls quelques tirs étaient encore envoyés. Autour du bateau éclataient encore dans les flots des bombes éparses. A propos de l’explosion de la tourelle César, nous n’avions rien remarqué. Pourtant, le navire tremblait continuellement à chaque coup qui éclatait à proximité. Avec une gîte de 80° environ, mon camarade et moi grimpâmes par-dessus le garde-corps du pont supérieur vers la coque blindée tribord. J’arrachai mon casque lourd de la tête et le jetai devant moi. Il sauta en grotesques bonds, par dessus la coque, dans l’eau.
Bientôt, il nous devint impossible de nous tenir debout sur le pont et nous nous agrippâmes au bastingage. Nos tirs de réplique baissèrent d’intensité, seuls quelques tirs étaient encore envoyés. Autour du bateau éclataient encore dans les flots des bombes éparses. A propos de l’explosion de la tourelle César, nous n’avions rien remarqué. Pourtant, le navire tremblait continuellement à chaque coup qui éclatait à proximité. Avec une gîte de 80° environ, mon camarade et moi grimpâmes par-dessus le garde-corps du pont supérieur vers la coque blindée tribord. J’arrachai mon casque lourd de la tête et le jetai devant moi. Il sauta en grotesques bonds, par dessus la coque, dans l’eau.
Il ne me restait plus aucune trace de peur. Je réfléchis rapidement à la manière de savoir comment je pourrais rapidement quitter le navire car on devait compter, à tout moment, sur de plausibles explosions susceptibles d’éclater à l’intérieur du navire et de le pulvériser.
Je m’efforçai d’atteindre l’arrière car c’est de là que la distance à la rive nous paraissait la plus courte.
Nous cherchâmes encore refuge derrière l’hélice bâbord car les avions de la 2ème vague survolaient à leur tour le bâtiment. Comme aucun tir de réplique ne partait plus du bâtiment, nous enjambâmes le safran tribord. Quant à moi, j’avais au préalable enlevé mes bottes et mon caban (Kolani), puis nous avons sauté dans l’eau.
Mon camarade originaire de Hamburg qui devait partir à Noël pour sa permission de mariage n’est plus reparu à la surface pendant que je tentais de nager vers la rive.
Sur la surface de l’eau, s’était formée puis étalée une épaisse couche d’huile provenant de l’éclatement des réservoirs de carburant stocké. Avant que je n’atteigne les bouées enfilées sur le filet de protection entourant l’aire d’ancrage du Tirpitz, je tombai sur un tronc d’arbre salvateur auquel je m’agrippais. Mes yeux embués d’huile me brûlaient affreusement et avec un mouchoir je me les essuyai. Ce qui fait que je n’ai pas souffert de l’irritation qu’ont connue beaucoup d’autres.
Au moment où un copain provenant de notre tourelle de tir nagea dans ma direction, j’aperçus un radeau de sauvetage qui dérivait par là : nous l’avons récupéré et grimpé dessus. Cela a été notre planche de salut !
Comme de trop nombreux camarades s’agrippaient sur les bouées accrochées au filet de protection, ces flotteurs coulèrent progressivement suite aux lourdes grappes humaines qui s’y étaient agglutinées.
Autour de nous, à côté des centaines de morts, dérivaient de nombreux nageurs qui cherchaient à se sauver. Rares étaient ceux qui avaient enfilé leur gilet de sauvetage, je n’avais également pas endossé le mien.
Je ne me souviens plus de la durée que j’ai passée dans l’eau, je n’avais plus la perception réelle des événements. De même je n’ai ressenti aucune froidure dans l’eau, je pense qu’elle avoisinait quelques degrés au-dessus de zéro. Peu de temps après, nous fûmes sortis de l’eau par un bateau de pêche norvégien qui nous ramena à bord du porte-canons anti-aériens, le Flakträger Thétis (ex-Tordenskold). On nous soigna en premier lieu avec du rhum, puis on coupa et arracha de nos corps nos habits souillés d’huile grasse, ensuite l’on nous dirigea vers les lavabos de bord. Le nettoyage de l’huile à coups de brosse à chiendent et de savon sous la douche fut une torture, un tourment que je garde toujours encore comme souvenir vivace en moi. On nous dota d’habits de fortune, le navire en disposait en petite quantité. Le lendemain, nous fûmes transportés à terre, à Tromsø. Nos vêtements n’étant pas suffisants, on nous affubla de couvertures de laine supplémentaires. Par hasard, un voisin de mon père m’avait aperçu à Tromsø et put donc lui signaler que j’étais vivant. ».
